
2149 Articles 19 Vidéos + 100 000 Visites / Mois Bouaké, Côte d'Ivoire
- BOUAKÉ / Visite du Vice-Président pour l’inauguration du CHR et de l’Hôtel de Ville : Les “3A” à la manœuvre pour une mobilisation historique
- Bouaké / Célébration de l’inauguration du CHR et de son nouvel Hôtel de Ville : Deux joyaux offerts par le Président Ouattara, selon le maire Amadou Koné
- Mankono / Drame : Une tempête fait des dégâts matériels importants- la clôture du préfet s'écroule
- Côte d'Ivoire/ 6ème édition du Festival International Féminin-Pluriel : Une Odyssée Culturelle et éducative à travers 6 villes du pays
- Bodokro / Développement Local : Maître Maxime Kouamé, ou l'Engagement d'un Leader au service de sa communauté
- Bouaké / Affaire ''Radiation de Tidiane Thiam'' La manifestation du PDCI RDA étouffée par un dispositif sécuritaire devant le Tribunal
- Bouaké / Santé : Une organisation fait don de matériel de première nécessité à la maternité de Kouassiblékro
- Sakassou / Accès aux soins de santé de base: Le village de Kpato a désormais un infirmier permanent
- PAQUINOU 2025 DANS LE GRAND V BAOULÉ : Entre retrouvailles traditionnellles et messages politiques
- Bodokro / Activités pascales : Maître Maxime Kouakou sur tous les fronts – Remise de forages et dons logistiques
Inter -Mali / Prise de Kidal par les Famas : La guerre conventionnelle gagnée , place à l'asymétrique ? L'analyse d'un expert de l'histoire millitaire
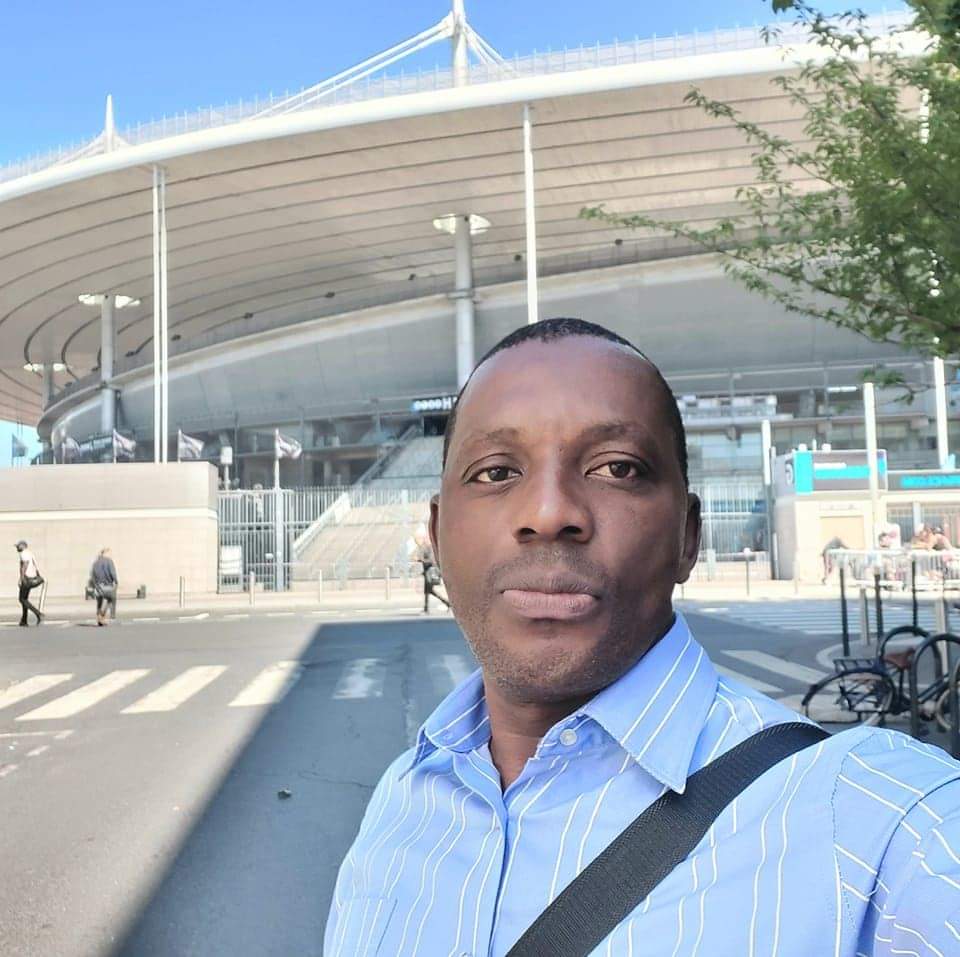
Dr Traoré Siaka, historien militaire, enseignant -chercheur à l’université Alassane Ouattara de Bouaké.
Kidal fait partie intégrante du Mali, c’est clair, mais, nul ne peut nier ce fait : il subsiste un contentieux séculaire entre les populations autochtones, à leur tête les chefs politiques et religieux locaux et l’Etat malien.
En allant s’installer sur cette terre, dans un climat de violation d’accord politique et de guerre ouverte, l’armée malienne et ses partenaires deviennent du coup des forces d’occupation.
Le savant grec Thucydide qui vécut au 5è siècle avant JC, aimait dire que l’histoire est un perpétuel recommencement, autrement dit, grâce au passé, l’avenir n’est guère une page blanche, il peut être prédit.
Pour les Famas qui croient avoir remporté le gros lot en pénétrant dans le fief de la rébellion touareg, l’avenir militaire n’est également guère une page blanche.
Des faits similaires qui émaillent l’histoire des armées d’occupation, nous confortent dans cette position.
1962 : Victime d’une guerre asymétrique, après une saignée de plus de 27 500 soldats tués et 1000 disparus, l’armée coloniale française quitta dare-dare le sol algérien. Cette pression fut l’œuvre du FLN qui se battait pour vivre dans l’honneur et la liberté, sur la terre léguée par leur ancêtre.
1975 : Après avoir occupé pendant des années le nord Viêtnam, l’armée américaine subit de plein fouet la guérilla vietnamienne. Plus de 50 000 jeunes américains périront avant que Nixon n’annonce le début du retrait. Ragaillardie par leur victoire à la seconde guerre mondiale, la plus puissante armée du monde subissait ainsi sa plus grande humiliation face à un peuple, dos au mur, sous-équipé qui n’avait d’autre choix que se battre jusqu’à la dernière goutte de sang.
En 1988, à leur tour, la grande armée de l’URSS faisait son amère expérience en Afghanistan, suite à neuf longues années d’occupation du pays. Pour soutenir son allié, le gouvernement communiste afghan, l’URSS avait déclenché une intervention armée en décembre 1979 en déployant près de 100 000 jeunes soldats soviétiques. La sentence fut terrible, 50% ne revirent jamais leur terre de Russie.

Ces exemples surabondent…
Tout près, de 2003 à 2012, lors de la seconde guerre d’Irak, les Etats Unis occupèrent militairement la Mésopotamie, nom de code : Opération Liberté irakienne.
Bagad tombe en avril 2003. Sorti d’un tunnel dans une ferme abandonnée, le 13 décembre 2003, Saddam Hussein est capturé, jugé et pendu. A Washington, c’est la liesse. La Maison Blanche sort même ses plus belles bouteilles de champagne et savoure sa victoire.
Mais, c’est lors de l’occupation qu’elle regrettera d’avoir déclenché cette énième guerre au moyen orient.
En 2011, à travers un article du journal Le Monde, Léon Panetta, le secrétaire à la Défense fit le décombre macabre de 4480 militaires américains tués et 33 000 blessés. Ce, à cause des attentats et divers actes de guérilla urbaine durant l’occupation.
Pour le cas du Mali, des interrogations dignes d’intérêt subsistent à l’heure où Kati célèbre son début d’installation dans une zone de guerre, sur laquelle, au-delà des rebelles touareg, elle aura pour principales ennemies les populations civiles, ces dernières qui n’abandonneront jamais leurs maris, fils, frères, cousins et oncles présents dans les rangs de la rébellion.
Submergées déjà sur le front de la lutte anti-terroriste contre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (en abrégé GSIM) et l’Etat Islamique au Grand Sahel (EIGS), comment quantifier les marges de manœuvre des FAMAS face à une potentielle guérilla urbaine des mouvements politiques armés touareg, avec la probable complicité des populations locales ?

Pourquoi ne pas en finir, d’abord, la guerre contre le terrorisme avant de s’en prendre aux mouvements touareg en arme qui, de leur côté, demeurent dans une logique de revendications politiques ?
Pourquoi ouvrir un deuxième front alors qu’on est en perte de vitesse sur le premier ?
On le sait, une guerre, ce sont des moyens financiers dans la durée. Alors, pourquoi disperser ses forces quand on a une armée guidée par des mercenaires, une armée d’un pays exsangue économiquement et financièrement, un pays où avoir l’électricité et l’eau courante 24H/24, relève d’un véritable luxe ?
Au regard de l’accord d’Alger, pourquoi ne pas faire, dans un premier temps, des Touaregs des alliés militaires dans l’éradication du terrorisme dans le septentrion malien. Puis, régler les problèmes avec ces derniers, une fois le premier objectif totalement et entièrement atteint ?
A mon avis, l’attaque éclaire sur le Nord, est un coup d’éclat pour cacher l’humiliation militaire contre le vrai fléau qui mine en ce moment le Mali, à savoir, l’insécurité causée par les mouvements terroristes.
Il s’agit de justifier la confiscation du pouvoir par une démonstration qui n’en vaut pas la peine.
Il faut mettre en exergue ses moyens militaires acquis, opérationnels uniquement dans le cadre d’une guerre conventionnelle, en vue de cacher les séries de défaites cuisantes, sur le champ de la guerre asymétrique livrée par les groupes salafistes.
Loin de moi, cette posture de prophète de malheur ou d’oiseau de mauvais augure.
Mais, ce que les cinq colonels climatisés doivent comprendre, la guerre à Kidal peut changer de logiciel, une fois l’occupation entamée.
Qu’ils se souviennent de ceci : d’une guerre conventionnelle à une guerre asymétrique, il n’y a qu’un minuscule fil.
Et, ce ne sont pas des ouaregs, dont le territoire vaste, aride et sableux faisant frontière avec l’éternelle complice, l’Algérie, qui diront le contraire.
Dr Traoré Siaka
Historien militaire
Enseignant-chercheur au département d’histoire de l’université Alassane Ouattara de Bouaké ( UAO)











